La capacité de stockage des Grands Lacs est de 22 950 Gm3 d’eau. Ce volume correspond à celui de plus de six millions de piscines aux dimensions olympiques.
Modernisation du complexe de Beauharnois‑Les Cèdres
Le complexe hydro-électrique
Le complexe hydroélectrique de Beauharnois‑Les Cèdres compte une trentaine d’ouvrages, notamment des barrages, des digues et des ouvrages régulateurs. Ceux-ci ont été construits entre 1911 et 1971 et contribuent encore aujourd’hui à réguler les eaux du fleuve Saint-Laurent pour permettre l’aménagement de la voie maritime et la production hydroélectrique aux centrales des Cèdres et de Beauharnois.
Hydro‑Québec a examiné ces ouvrages pour déterminer quels travaux seront requis à l’avenir afin d’en assurer la pérennité. Ces investigations ont confirmé la nécessité de planifier plusieurs investissements pour moderniser le complexe de Beauharnois‑Les Cèdres au cours des prochaines décennies afin d’en prolonger la durée de vie.
Source de l’énergie produite dans le Suroît
Le potentiel hydroélectrique du Suroît et le canal de Beauharnois ont évolué parallèlement au développement des voies de navigation sur le fleuve Saint‑Laurent entre les lacs Saint‑François et Saint‑Louis, entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, en partenariat avec le gouvernement fédéral et la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint‑Laurent CGVMSL.
Regroupant le bassin versant des Grands Lacs et le fleuve Saint‑Laurent, ce système hydrographique s’étend de part et d’autre de la frontière entre le Canada et les États‑Unis.
La gestion de ce système relève de multiples instances canado‑américaines, chapeautées par la Commission mixte internationale. Ses ressources hydriques sont utilisées à de nombreuses fins, dont la production d’hydroélectricité.
L’eau qui se déverse dans le fleuve effectue tout un parcours avant d’arriver dans la région du Suroît. Le Saint‑Laurent prend en effet naissance à la sortie du lac Ontario, le dernier des cinq Grands Lacs par rapport au sens de l’écoulement de l’eau.
Limites de la régularisation
Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint‑Laurent gère les apports en eau du fleuve en tenant compte de l’ensemble du système, du lac Ontario jusqu’au lac Saint‑Pierre, y compris le secteur de l’archipel de Montréal. La régularisation joue un rôle non seulement pour la production hydroélectrique, mais aussi pour la navigation commerciale et de plaisance ainsi que pour les utilisations municipales, industrielles et résidentielles de l’eau. Cette régularisation du débit permet de modérer les impacts associés aux variations des niveaux du fleuve Saint‑Laurent, sans toutefois les éliminer complètement.
Hydro-Québec et la gestion des eaux du fleuve Saint‑Laurent.
Notre expert vous explique de quelle façon Hydro-Québec et ses partenaires contribuent à la gestion de la crue printanière dans le fleuve Saint‑Laurent.
Les partenaires de la régularisation du Saint-Laurent
-
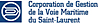
La voie maritime du Saint-Laurent a été aménagée dans le but d’assurer la navigation sur le fleuve, grâce à un partenariat binational entre les États-Unis et le Canada, et elle continue d’être exploitée à cette fin. En plus des huit écluses du Welland (États‑Unis), les 15 écluses de la Voie maritime du Saint-Laurent (13 écluses canadiennes et 2 américaines) permettent la navigation entre Montréal et le lac Érié. La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint‑Laurent
 est responsable de la gestion de la voie maritime sur le territoire canadien. Ce partenaire de premier ordre est étroitement lié au développement du potentiel hydroélectrique du Suroît.
est responsable de la gestion de la voie maritime sur le territoire canadien. Ce partenaire de premier ordre est étroitement lié au développement du potentiel hydroélectrique du Suroît. -
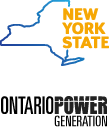
En plus d’Hydro‑Québec, deux autres producteurs d’énergie jouent un rôle important dans la régularisation du Saint‑Laurent : la New York Power Authority (NYPA)
 , la plus grande société d’État du secteur de l’énergie des États-Unis, et l’Ontario Power Generation (OPG)
, la plus grande société d’État du secteur de l’énergie des États-Unis, et l’Ontario Power Generation (OPG) , société d’État qui produit environ 50 % de l’électricité consommée en Ontario.
, société d’État qui produit environ 50 % de l’électricité consommée en Ontario. -

La Commission mixte internationale
 , créée en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909, est investie de deux responsabilités principales : régir l'utilisation des eaux communes et enquêter sur les problèmes transfrontaliers en vue de recommander des solutions. Dès les années 1950, la CMI a approuvé des projets visant à régulariser les eaux du fleuve Saint‑Laurent et à accommoder divers usages par exemple à des fins domestiques, de navigation et de production hydroélectrique.
, créée en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909, est investie de deux responsabilités principales : régir l'utilisation des eaux communes et enquêter sur les problèmes transfrontaliers en vue de recommander des solutions. Dès les années 1950, la CMI a approuvé des projets visant à régulariser les eaux du fleuve Saint‑Laurent et à accommoder divers usages par exemple à des fins domestiques, de navigation et de production hydroélectrique. -

Par son ordonnance d’approbation de 2016, la CMI a créé le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Sain‑Laurent (CILO‑FSL)
 , dont la principale fonction est de veiller à ce que le débit à la sortie du lac Ontario respecte les exigences de l’ordonnance de la CMI. Le Conseil veille aussi à informer le public sur le niveau de l’eau et la régulation du débit.
, dont la principale fonction est de veiller à ce que le débit à la sortie du lac Ontario respecte les exigences de l’ordonnance de la CMI. Le Conseil veille aussi à informer le public sur le niveau de l’eau et la régulation du débit. -

Les experts d’Hydro‑Québec travaillent activement afin de réduire les impacts négatifs des crues printanières sur les populations. Apprenez‑en plus sur le rôle d’Hydro‑Québec et de ses partenaires dans la gestion des crues printanières.
Description des installations
Construit à partir de 1911, le complexe hydroélectrique de Beauharnois‑Les Cèdres a joué un rôle crucial dans le développement de l’hydroélectricité au Québec. Encore aujourd’hui, il continue d’occuper une place de premier plan dans le parc de production d’énergie propre et renouvelable d’Hydro‑Québec.
Les ouvrages qui le composent ayant entre 50 et 107 ans, Hydro‑Québec a réalisé réalise actuellement des études et des investigations afin de déterminer quels travaux seront nécessaires pour en assurer la pérennité et prolonger leur durée de vie de plusieurs décennies.
Le complexe regroupe deux centrales, soit la centrale de Beauharnois et la centrale des Cèdres, ainsi que neuf ouvrages régulateurs : les barrages du Coteau‑1, du Coteau‑2, du Coteau‑3, du Coteau‑4, de l’Île‑Juillet‑1, de l’île‑Juillet‑2, de Saint‑Timothée, de la Pointe‑du‑Buisson et de Pointe‑des‑Cascades. Il comprend également les digues du canal de Beauharnois, d’une longueur de plus de 50 km.
- Neuf ouvrages régulateurs
- Plus de 50 kilomètres de digues
- Âge des ouvrages : entre 50 et 107 ans
Info-projet – Modernisation du complexe de Beauharnois-Les Cèdres
Inscrivez-vous à la liste d'envoi pour être informé de l'avancement des travaux et des différentes étapes de ce projet.
M'abonner à l’infolettre du Modernisation du complexe de Beauharnois-Les CèdresÉchangez avec nous
Nous souhaitons établir un dialogue avec vous. Nous vous invitons donc à soumettre vos questions et commentaires sur le projet.
