Nous travaillons à réduire les impacts des crues
Chaque année, nos spécialistes travaillent activement pour utiliser notre réseau d’installations de façon optimale afin de limiter les impacts des crues printanières sur la population.
Pour plus d'information :
Hydro Québec réalise des webinaires pour les régions touchées par les crues. Visionnez les rencontres :
Webinaires 2025
Webinaires 2024
Veuillez noter que les données sur les crues présentées dans les webinaires ci-dessous sont celles de 2024 et ne correspondent pas à celles de 2025. Toutefois, les principes de gestion hydrique qui y sont utilisés s’appliquent d’une année à l’autre.
Un outil pour connaître les débits et les niveaux d’eau
Nous installons des instruments de mesure sur les rivières et les réservoirs où nous exploitons des barrages et des centrales. Ils nous fournissent des données sur les débits, les niveaux d’eau et les conditions météorologiques. Ces données sont mises à votre disposition au moyen d’un outil simple. Consultez-le pour connaître les débits des cours d’eau et les niveaux d’eau dans les réservoirs.
Découvrir l’outil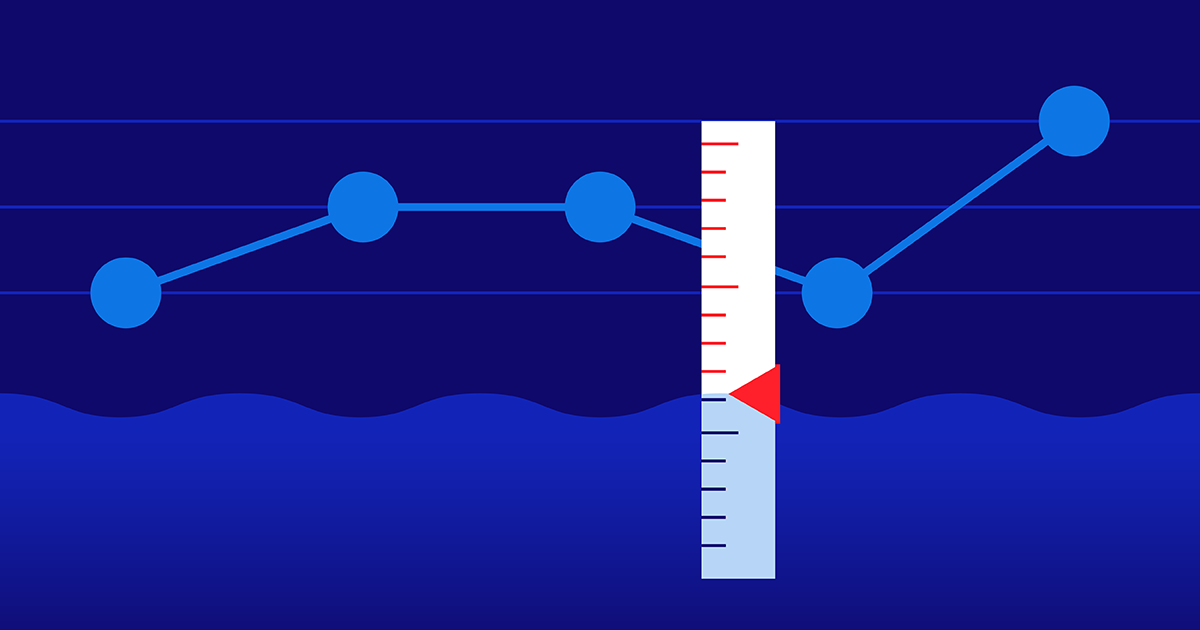


Des actions particulières dans chaque région
Partout où nous avons des installations hydrauliques, nous les mettons à profit pour réduire les impacts de la crue printanière sur la population. Plusieurs facteurs propres à chaque région influent toutefois sur l’intensité des crues : l’ampleur du bassin versant, les caractéristiques du réseau hydrographique, le type d’aménagement (à réservoir ou au fil de l’eau), la présence d’installations hydrauliques de nos partenaires et, surtout, les conditions météorologiques. Apprenez‑en plus sur la gestion hydrique spécifique à votre région.
Hydro‑Québec met en œuvre son Plan d’adaptation aux changement climatiques.
Découvrez comment sa gestion hydrique s’adapte continuellement aux changements climatiques.
Foire aux questions
Les installations d’Hydro‑Québec ont-elles une influence sur les impacts des crues ?
Qu’est-ce qu’une centrale au fil de l’eau et pourquoi une telle centrale ne peut pas vraiment limiter les impacts de la crue printanière ?
Pourquoi le niveau d’eau en amont d’une centrale au fil de l’eau est-il si bas durant la crue printanière ?
Pourquoi dit-on que la quantité de neige et les précipitations de régions plus au nord ont un impact sur l’ampleur de la crue printanière dans les régions plus au sud ?
Les employés d’Hydro‑Québec gèrent-ils les débits d’eau en période de crue printanière seulement ?
Hydro‑Québec gère-t-elle seule les débits des rivières sur lesquelles elle a des installations ?
Où pouvons-nous nous renseigner sur les niveaux d'eau et les débits enregistrés dans les rivières du Québec lors de la crue printanière ?
En période de crue, Hydro‑Québec est-elle responsable d’informer le public sur les risques d’inondation et sur la marche à suivre en cas d’inondation ?
Pourquoi n’est-il pas possible d’informer à l’avance les riverains des variations de débit et de niveau d’eau ?
Le saviez-vous ?
- La préparation à la crue printanière dure plusieurs mois à Hydro‑Québec et nous misons sur des météorologues, des ingénieurs et ingénieures, des hydrologues et même des océanographes afin de bien suivre l’évolution des cours d’eau.
- Chaque printemps, les réservoirs situés dans la partie sud du Québec sont à leur plus bas niveau pour retenir un maximum de l’eau issue de la fonte des neiges.
- Dans certaines régions, la quantité d’eau ainsi retenue représente jusqu’à 40 % de toute l’eau qui se retrouve sur le territoire.
- Le réservoir Gouin, situé en Haute-Mauricie, est surnommé le gardien du Saint-Maurice et sa construction a été terminée en 1917. Envie d’en savoir plus ? Visitez la page consacrée au barrage Gouin.
- Le bassin versant de la rivière Saint-Maurice s’étend sur 42 651 km2, soit un territoire plus grand que les Pays-Bas.
- Le bassin hydrographique de la rivière des Outaouais est trois fois plus grand que le territoire de la Suisse et une goutte d’eau peut mettre jusqu’à trois semaines pour traverser ce bassin, de sa source jusqu’à la région de Montréal.
- On retrouve treize principaux réservoirs dans le bassin de la rivière des Outaouais et
Hydro‑Québec n’est propriétaire que de quatre d’entre eux. La Commission de planification de la
régularisation de la rivière des Outaouais
 assure la gestion intégrée des
réservoirs de tous les partenaires.
assure la gestion intégrée des
réservoirs de tous les partenaires. - Hydro‑Québec a inventé et commercialisé un appareil, le GMON, qui permet de déterminer
au quotidien la quantité d’eau contenue dans la couverture de neige. En apprendre plus sur l’appareil GMON
 .
. - Plusieurs centrales hydroélectriques ne peuvent aucunement retenir l’eau au printemps. On les appelle centrales au fil de l’eau et la majorité des centrales situées dans le sud du Québec sont de ce type.









